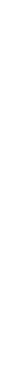L'histoire de décembre: Cuba Libre
Page 1 sur 1
 L'histoire de décembre: Cuba Libre
L'histoire de décembre: Cuba Libre
Quand j’ai eu cette lettre d’un transporteur, m’annonçant qu’un colis de deux cents kilos m’attendait au Havre, j’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur ou d’une plaisanterie. Bien sûr, je n’ai pas donné suite. A mon âge, il reste bien peu de choses importantes dont on se préoccupe chaque jour et celle-ci n’en faisait pas partie. Ce n’est que lorsqu’une charmante dame m’a téléphoné, deux semaines plus tard, pour me demander si j’avais bien reçu leur courrier, que j’ai pris cette annonce au sérieux. Bien sûr, j’ai voulu connaître la nature de ce fameux colis. La jeune femme n’a pas pu me répondre tout de suite mais a promis de me rappeler sitôt qu’elle en saurait plus. De mon côté, il était absolument hors de question que je me rende au Havre comme on me le demandait sans en savoir plus !
La réponse est tombée quelques heures plus tard par courrier électronique : motocyclette BSA type B34. Le courriel était accompagné du document des douanes certifiant que la marchandise avait été dédouanée dans les règles ainsi que d’une photo. Quand je l’ai vue, j’ai eu un grand choc. On y voyait effectivement une BSA Goldstar en caisse. Cette photo m’a ramené brutalement cinquante ans en arrière, à l’époque où j’avais vingt ans. Si je n’avais pas été assis, je me serais effondré sur place. Mes jambes flageolaient, sans force, mes mains tremblaient et ma vue se brouillait. Mon Dieu, cette moto ! Tous ces évènements qui remontaient si loin ! C’était au siècle dernier !
Le lendemain je suis monté dans le train pour le Havre. Une fois assis, je me suis laissé envahir par tous ces souvenirs. C’était à la fin des années cinquante, de l’autre côté de l’océan. C’était à Cuba !
JANVIER
Je venais de sortir de l’école de journalisme et je m’étais fait engager par un grand quotidien national. A cette époque, tous les yeux étaient tournés vers le ciel. On écoutait, fasciné et inquiet, les bip-bip de Spoutnik. C’était le début de la guerre en Algérie. Evidemment, pas question d’envoyer un bleu là-bas pour couvrir ces évènements. Comme je me languissais à Paris, mon rédacteur en chef, qui m’avait à la bonne, a décidé de m’envoyer à Cuba voir ce qui s’y passait. Une bande de rebelles avait tenté un débarquement en Décembre mille neuf cent cinquante six dans l’espoir de renverser le gouvernement du président Batista. Bien sûr, l’opération avait lamentablement échoué. Depuis, le pays sombrait lentement dans le chaos et la guerre civile.
Ainsi, quelques heures après le Jour de l’An mille neuf cent cinquante huit, je prenais un avion de la TWA en direction de la Floride. Je n’y séjournais que le temps de goûter aux hamburgers et au Coca-Cola avant de sauter dans un vieux DC3 qui m’a emmené directement à La Havane.
Le ciel était gris et plombé à mon arrivée, bien loin de l’image idyllique que je me faisais des Caraïbes. Une fois là-bas, j’ai pris rendez-vous avec notre contact sur place, un certain Juan Montanez. Le gars était sympathique. Il m’a expliqué la vie à Cuba, les magouilles, les filles, puis il m’a emmené dans un bar, dans les bas-fonds. Un orchestre jouait de la salsa. Nous, on s’est assis un peu à l’écart, dans la pénombre. Je me souviens qu’il y avait beaucoup de fumée. Forcément, on s’est mis à boire. Je devrais plutôt dire à picoler. Du gin, du whisky, du rhum, etc… des trucs d’hommes quoi ! Au bout d’un moment, la serveuse a refusé de nous servir, tellement on était saoul. Elle s’est mise à hurler après Juan et moi quand on a renversé plus de verres qu’on en a bu. Je me suis levé tant bien que mal, j’aie jeté un paquet de dollars US sur la table et on est sorti en beuglant et en chantant. Je ne me souviens même plus comment je me suis rendu à mon hôtel. Toujours est-il que lorsque je me suis réveillé, le lendemain matin, j’étais dans une magnifique chambre avec une superbe casquette plombée sur le crâne ! J’ai du traîner une bonne heure sur mon lit, incapable d’aligner deux pensées sensées de suite.
Quand la réception a appelé, la sonnerie du téléphone m’a vrillé les tympans.
- Monsieur Thomas Longchamps ?
- Mmmmh !
- Ici la réception Monsieur Longchamps. Monsieur Juan Montanez demande à vous voir.
- Faîtes-le monter… et amenez-moi aussi du café très fort.
La réceptionniste s’est empressée de me dire que Montanez était déjà en route et que le café arriverait sous peu. Juan est entré, gai comme un pinson, fringant, en pleine forme, comme s’il sortait d’une longue nuit de repos. A croire que l’alcool n’avait aucun effet sur lui. Il était un petit peu plus petit que moi, un peu plus âgé aussi. La moustache arrogante, le cheveu noir et bouclé et le teint mat.
- Buenos dias amigo ! Comment tu vas ?
- Impossible à dire pour le moment Juan. On en parlera quand j’aurai bu un café.
J’avais la langue pâteuse et l’haleine chargée. J’avais aussi besoin d’une bonne douche pour chasser les derniers miasmes de cette soirée.
Quand je suis ressorti de la salle de bain, j’avais les idées un peu plus claires. Tout en buvant un café noir comme l’enfer, j’ai parlé à Juan de ce que j’avais l’intention de faire. Il fallait absolument que je parvienne à approcher les rebelles pour décrocher une interview de leur chef, un certain Fidel Castro. Il me fallait aussi un moyen de transport léger et rapide qui puisse m’emmener partout dans l’île, même dans les endroits les moins accessibles. Juan a immédiatement pensé à une bonne Jeep mais j’ai refusé. Trop gros, trop … militaire et surtout j’aurais été obligé d’emmener Juan partout avec moi. Or, c’était exactement ce que je voulais éviter. Juan était sympathique, bon vivant et il connaissait beaucoup de monde, trop de monde peut-être. J’étais persuadé que pour pouvoir approcher les rebelles, il faudrait la jouer discret et silencieux. Tout le contraire de mon guide.
Donc, il me faudrait une moto. J’adorais la moto. Même chez nous, je roulais par tous les temps. A Paris, c’était beaucoup plus rapide (même s’il n’y avait pas encore autant de circulation que de nos jours) et plus drôle (quel plaisir de semer les « hirondelles » à vélo). Juan fît la moue. On voyait bien que cette histoire de « motocicleta » ne lui plaisait qu’à moitié, mais comme c’était moi qui le payais, il a fini par accepter. Pas le choix de toute façon. Il m’a promis qu’avant le soir même j’aurai mon engin. On s’est donné rendez-vous dans le même bar que celui de la veille, le Buena Vista Club, vers vingt heures. Après un « buen dia amigo ! » sonore, il est parti en me laissant fignoler mes plans. Après m’être habillé et avoir envoyé un télégramme à Paris pour donner de mes nouvelles, je suis sorti pour traîner dans les rues de La Havane. Je voulais prendre le pouls de cette ville, de cette nation. Partout où je passais, il y avait de la musique qui sortait d’une arrière cour, une femme qui chantait derrière ses fenêtres ouvertes ou des gamins qui riaient en jouant. Mais il y avait aussi des soldats qui patrouillaient, des flics, des « gringos » américains qui se prenaient pour les rois du monde. Beaucoup trop d’uniformes à mon goût et donc aucune chance de prendre contact avec les hommes de Castro. De toute façon personne ne savait exactement où ils se trouvaient. Il se passait des choses dans l’est de l’île et moi je me trouvais tout au nord-ouest, à huit cent kilomètres de là. Il me tardait d’avoir ma moto et de filer aussi vite que possible vers l’est. Pour occuper le restant de la journée, je décidais de me dégotter une carte et de préparer mon itinéraire vers Bayamo. Il fallait que je m’approche aussi près que possible de la zone que maîtrisaient les rebelles. J’avais l’intention de suivre la côte au nord de l’île. D’abord Varadero, Cardenas, Sagua La Grande, Moròn, Nuevitas, Holguin et enfin Bayamo. Suivant la situation là-bas, je pourrais toujours essayer de rejoindre Santiago de Cuba, à l’extrême sud du pays.
Le soir approchant, je rassemblais mes affaires, je vérifiais mon appareil photo, mes pellicules et je fourrais le tout dans un grand sac de paquetage kaki. Enfin l’heure de mon rendez-vous avec Juan est arrivée. Je me suis rendu au Buena Vista Club à l’heure dite. Il y avait encore peu de monde à cette heure-ci. Bien sûr Juan était en retard. J’ai commandé des langoustines. C’est au moment où j’ai commencé à manger que je me suis rendu compte à quel point j’avais faim. Si faim que j’ai commandé une deuxième assiette, sitôt la première vidée. Je venais à peine de l’entamer que j’ai entendu au dehors le son caractéristique d’un moteur monocylindre haut dans les tours. Se pouvait-il que ce soit Juan qui arrivait à moto ?
J’ai fait comme les autres clients du bar : je suis sorti pour voir ce qui causait tout ce bruit. C’était bien mon contact qui s’amusait à monter et descendre la rue à toute vitesse au guidon de son engin pétaradant. Quand il m’eut repéré au milieu de la foule, il s’est mis debout sur les cale-pied pour hurler au moment où il passait à ma hauteur :
- Tu avais raison Thomas, elle est super cette motocicleta ! Mui bien !
Quand il fut satisfait du nombre de spectateurs qui l’admirait, Juan a enfin décidé de s’arrêter pour me montrer sa trouvaille. Il s’agissait d’un véritable bijou : une BSA Goldstar. Cette moto était déjà rare et chère à l’époque.
- Tu es content Thom ? Tu sais ça n’a pas été facile d’en trouver une. Pourquoi tu ne voulais pas plutôt une Jeep ? Ça aurait été beaucoup plus facile et surtout moins cher !
Il m’avait dit cela sur le ton de la conspiration. Sans me laisser le temps d’admirer la machine, Juan m’a entraîné dans le bar et s’est jeté sur mon assiette de langoustines froides. Pour être franc, je n’ai pas compris grand’ chose aux explications qu’il m’a fournies, mais il m’a bien fait comprendre que c’était cher, très cher même.
Je n’étais pas encore assez bourré pour ne pas saisir le message caché. Je lui ai demandé combien cela me coûterait de récupérer la BSA. Là, d’un seul coup, il est redevenu sérieux comme un pape. Il a reposé la dernière langoustine dans l’assiette, s’est essuyé lentement les mains et m’a regardé droit dans les yeux.
- Thom mon frère, la motocicleta, là dehors, je l’ai pas vraiment achetée. Elle appartenait à un americano, mais il n’en a pas vraiment besoin. Donne-moi deux cent cinquante dollars et elle sera à toi.
C’était une sacrée somme ! Je savais pertinemment que ça ne passerait jamais sur une note de frais mais il me fallait absolument un véhicule pour rejoindre Bayamo. Je disposais en tout et pour tout de deux cents dollars en liquide à l’hôtel. J’expliquais la situation à Juan. Finalement, au bout d’une heure de discussion, il a accepté de descendre son prix. Une fois d’accord, on est reparti à fond de train dans les rues de La Havane, lui pilotant et moi en place passager. L’air frais du soir m’a aidé à retrouver mes esprits et je me suis rendu compte que Juan n’était pas aussi bon pilote que ça. On venait d’éviter notre troisième collision avec une voiture (une grosse Cadillac je crois) quand je lui ai tapé sur l’épaule. Tout en roulant il s’est mis à hurler :
- Qu’est ce qu’il y a amigo ?
- J’aimerais bien rouler aussi !
- Quoi ?
Le vent, le bruit du moteur ; Juan ne comprenait rien (ou ne voulait rien comprendre) à ce que je disais. Mais à force d’insister et de lui taper sur l’épaule, il a fini par s’arrêter le long de la route qui longe la mer. Je lui ai répété que je voulais rouler.
- OK amigo. Je vais t’expliquer comment la démarrer.
Pour ne pas vexer mon hôte, je n’ai rien dit. Je pilotais des anglaises depuis que mes jambes étaient assez longues pour toucher le sol une fois en selle.
On est rentré directement à l’hôtel où je me suis acquitté de ma dette. J’avais l’intention de partir de La Havane le lendemain à l’aube. Quand Juan a appris ça, il m’a emmené au bar de l’hôtel où on a bu jusqu’à plus soif à ses frais. Nos adieux ont été poignants. On ne se connaissait pas depuis deux jours qu’il me considérait déjà comme son frère ( un frère qu’il avait allégé de deux cents dollars quand même) !
Le lendemain, avant de partir, j’ai appelé le journal à Paris pour les informer de mes intentions pour les prochaines semaines. Je ne savais pas quand je pourrais les joindre à nouveau et je voulais qu’ils le sachent.
Le démarrage à froid de la BSA était un véritable cérémonial :
Il fallait ouvrir l’essence et titiller le carburateur jusqu’à ce que la cuve déborde, puis tirer la poignée d’embrayage et donner un coup de kick pour vérifier qu’il ne collait pas. Donner deux coups de kick, mettre le contact et un poil de gaz. Enfin donner un dernier coup de kick énergique mais pas bourrin et c’était parti ! Tout dans la classe et la décontraction. Le temps que la moto chauffe gentiment sur sa béquille, j’ai accroché mon paquetage sur la selle passager et j’ai payé ma note. Comme il ne me restait plus un sou, j’avais demandé une avance sur mon salaire. Le boss avait râlé au téléphone, surtout que je n’avais pas encore pondu un seul article. Il avait fallu que je lui explique que les rebelles essayaient de contrôler l’est de l’île et qu’il fallait que je m’y rende pour avoir quelque chose à raconter.
Je me suis rapidement mis en route, direction Varadero. Cette ville se trouvait à une bonne centaine de kilomètres de La Havane et il m’a fallu plus de deux heures pour la rejoindre. Mais peu m’importait, je n’étais pas pressé. Je pensais atteindre Moron avant la fin de la journée, mais dans la Caraïbe les choses ne se passent jamais comme prévu. A force de m’arrêter pour admirer le paysage, la mer, de prendre des photos pour mes futurs articles, je ne suis pas arrivé plus loin que Sagua La Grande. J’ai foncé dans le seul hôtel pas trop miteux de cette ville pour y prendre quelques heures de repos. Comme je n’arrivais pas à dormir, j’ai décidé de me relever pour aller traîner dans les rues animées de cette citée. Je me suis laissé attirer par la musique d’un petit bar et tout en m’asseyant à une table, j’ai commandé un rhum. La serveuse a semblé surprise. D’habitude les « gringos » préféraient le whisky à la boisson locale. J’ai pris soin cette fois-ci de ne pas boire plus que de raison.
Le lendemain, je suis reparti sur ma vaillante BSA en direction de Moron. Partout je voyais le petit peuple cubain au travail, s’exténuant au service des grands propriétaires terriens. Partout je voyais la misère et l’oppression. Je commençais enfin à toucher du doigt l’âme de cette île, de son peuple. Je me suis arrêté plus souvent, plus longtemps pour parler aux cubains de souche. Il y avait toujours dans leurs yeux cette crainte de l’homme blanc, du patron, du chef d’exploitation, qui était plus prompt à frapper qu’à discuter. Quand j’ai compris cela, j’ai peaufiné ma technique. J’abordais les travailleurs à l’ouvrage dans les champs sous prétexte de demander mon chemin. Je faisais mine de chercher mes mots pour bien faire comprendre que je n’étais pas américain mais français. Je devenais bien vite le Français à la motocicleta, et le soir quand je me promenais en ville, certains me reconnaissaient. Il suffisait alors de quelques verres pour qu’ils me parlent ouvertement de leur vie de misère, de leur patron et de leurs aspirations. Quand je demandais s’ils savaient quelque chose à propos des rebelles, certains se taisaient, mais la majorité d’entre eux en avaient seulement vaguement entendu parler. Ils étaient loin, plus loin à l’est. Ils étaient presque tous morts à Cienfuegos à la fin de l’année précédente, écrasés sous les bombes des B26 américains.
Après Moron, ma route m’a conduit vers Esmeralda. Quel joli nom, quelle affreuse ville. J’y ai assisté en plein jour à l’assassinat d’un paysan : le gouverneur local le soupçonnait d’avoir apporté son soutien aux révolutionnaires ! Plus je me dirigeais vers l’est de l’île et moins on les appelait des rebelles. Après Esmeralda, ce fût Nuevitas, Las Tunas, Holguin, puis Bayamo. Partout la même misère, la même oppression. En arrivant à Bayamo, j’ai senti une certaine tension dans la ville, comme de l’électricité dans l’air. Il y avait beaucoup plus de militaires et de flics dans les rues que partout ailleurs dans l’île. Les contrôles d’identité étaient plus fréquents mais aucune destination ne m’était encore interdite. Il faut dire que le fait de voyager à motocyclette m’attirait plus la sympathie de ceux que je croisais que la suspicion. Et puis, je ne me gênais pas pour forcer mon accent français et préciser que j’étais journaliste. Il me suffisait alors de prendre le chef des pandores en photo, assis sur ma moto, et de lui promettre de la lui envoyer pour qu’on me fiche la paix et qu’on me laisse continuer mon périple.
Après avoir traîné à Bayamo quelques jours sans y récolter la moindre information intéressante, ni y voir l’ombre d’un révolutionnaire, j’ai décidé de pousser jusqu’à Santiago de Cuba. Je commençais à me poser des questions : et si toute cette histoire de Castro et de débarquement n’était plus que des informations éventées ? Et si tout cela s’était terminé en Septembre mille neuf cent cinquante-sept sous les bombes américaines, à Cienfuegos ?
J’ai décidé que si je ne voyais rien de plus intéressantes une fois arrivé à Santiago, je regagnerai La Havane et la France au plus vite. Je suis arrivé à Santiago à la tombée du jour, et conformément à mes habitudes, j’ai traîné deux bonnes heures dans les rues de cette ville. Bien qu’il n’y ait pas de couvre-feu en vigueur, elles étaient presque désertes. Je suis entré dans le premier bar dont la musique m’attirait. C’est là que je l’ai vue pour la première fois ! Elle était belle, svelte et bien faite de sa personne. Elle portait ses longs cheveux noirs tressés en une natte qui se balançait au rythme de sa démarche souple. Ses yeux tristes et sombres, lançaient parfois des éclairs de haine. Je ne me souviens plus de ce qui m’a le plus attiré en elle. Maria était serveuse dans ce bar sombre dont l’air était lourd de la fumée des cigares. L’atmosphère y était chaude, presque suffocante. J’ai eu du mal à passer ma commande tant elle me fascinait et il a fallu que je m’y reprenne à deux fois pour demander une bière.
Je suis resté là une bonne partie de la nuit à l’observer et à siroter ma Budweiser, ne recommandant que lorsqu’elle venait me relancer. Je ne suis rentré à mon hôtel que très tard dans la nuit, quand le bar a fermé et que l’on m’a chassé avec les derniers clients.
Le lendemain, je me suis mis à la recherche de quelqu’un qui pourrait me mettre en contact avec les hommes de Castro, voir même avec leur chef lui-même. J’ai tourné dans la région pendant des jours, suivant ici et là les « on dit » et les rumeurs. Mais soit il ne se passait rien quand j’arrivais, soit l’accrochage entre les soldats et les rebelles était déjà terminé. J’avais même, je dois l’avouer, le sentiment que l’on me renseignait mal à dessein, afin me tenir à l’écart de l’action. Et chaque soir je rentrais bredouille, sans avoir ramené la moindre photo, sans avoir assisté au moindre combat. Je me rendais directement au bar où Maria servait et je passais ma soirée à la dévorer des yeux.
FEVRIER
On était à la veille du vingt-sept Février mille neuf cent cinquante-huit quand Maria est venue me voir à ma table. Quand elle s’est approchée de son pas chaloupé, mon cœur s’est mis à battre un peu plus fort. Que me voulait-elle ? Je venais de commander un rhum et mon verre était encore plein. Qu’allais-je pouvoir lui dire pour qu’elle reste un peu plus longtemps près de moi ? Elle s’est penchée par dessus la table, m’offrant le spectacle divin du haut de son décolleté. Elle s’est approchée tout près et m’a chuchoté la chose suivante à l’oreille :
- Gringo, si demain tu veux survivre, ne sors pas de Santiago. Après tu auras ce que tu cherches.
Sans un mot de plus, elle s’est éloignée pour reprendre son service au milieu de la musique et de la fumée. J’en suis resté bouche bée un bon moment. Quand elle est repassée à proximité de ma table, je lui ai attrapé le poignet. Le regard qu’elle m’a lancé était si noir que je l’ai immédiatement relâchée. Mais je lui ai quand même posé la question qui me brûlait les lèvres :
- Que va-t-il se passer demain signora ?
- Ne m’en demande pas plus. Si tu veux obtenir ce que tu cherches, fais ce que je t’ai dit !
Plusieurs paires d’yeux s’étaient tournées vers nous et j’ai préféré ne pas insister, mais j’ai décidé d’attendre Maria à la fin de son service. Il fallait que je sache de quoi elle voulait parler.
L’entrée du personnel se situait dans la petite cour de l’immeuble où se trouvait la taverne. J’ai fait les cent pas en attendant de la voir venir et au moment où elle est apparue, un gros type en uniforme est sorti de l’ombre et s’est rué sur elle en hurlant et en l’insultant. Quand il l’a saisie par le bras et l’a jetée à terre, mon sang n’a fait qu’un tour. Sans réfléchir, je me suis précipité pour lui porter secours. J’ai porté un direct du droit au gros flic qui a basculé dans le caniveau. Je me suis acharné sur lui à coup de poings et de pieds. C’est à peine si j’entendais Maria hurler, me supplier d’arrêter, me tirer par le bras. Quand elle est enfin parvenue à m’arracher à son agresseur, on s’est enfui en courant. Elle ne cessait de crier que j’étais « loco » et que j’allais payer très cher ce que je venais de faire. Elle m’a conseillé de prendre ma moto et de ficher immédiatement le camp de la ville, de quitter la région et même l’île. J’ai refusé de lui obéir tant qu’elle ne m’aurait pas dit ce qui allait se passer le lendemain. Ses menaces n’y ont rien fait. Finalement on en est arrivé à un compromis : je cherchais ma BSA à l’hôtel et elle acceptait de m’accompagner hors de la ville pour tout m’expliquer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et nous voilà en route en pleine nuit vers Chivirico. On s’est arrêté sur la plage et elle m’a tout raconté. Elle m’a prévenu qu’une fois que je serai au courant, ma vie à Cuba ne pourrait plus jamais être comme avant. Mais je venais de battre un agent de police comme plâtre : ma vie ne pourrait de toute façon plus jamais être comme avant !
Le pandore que je venais de rosser était son père. Il était venu lui soutirer des informations. Il l’a soupçonnait, à raison, de faire partie des révolutionnaires qui sévissaient dans la région. Le vingt-sept février, les rebelles avaient prévu d’augmenter les opérations de guérilla et d’ouvrir un second front au nord de Santiago. Mon intervention risquait de mettre en péril cette opération. Son père, chef de la police de Santiago, allait certainement mettre tout le monde disponible à notre recherche. Il ne nous restait qu’une seule solution : rejoindre les combattants castristes pour échapper aux recherches.
Je me rappelle que la nuit était douce et claire et que l’étoile du berger brillait fort. Maria semblait perdue et triste. J’ai rassemblé du bois mort et j’ai fait un feu sur la plage. Malgré la température relativement clémente, elle frissonnait. Je l’ai prise dans mes bras pour la réchauffer. Je l’ai sentie se raidir quand je l’ai embrassée mais elle n’a pas opposé de résistance à mon étreinte. L’obscurité m’a aidé à lui avouer ce que je ressentais pour elle. Je lui ai dit mon amour, sa beauté qui me fascinait, ses yeux qui me charmaient et me faisaient peur aussi. Il me semblait que c’était la première fois que quelqu’un lui faisait une déclaration d’amour aussi sincère. Cette nuit-là, nous nous sommes enlacés, nous avons dansé, joue contre joue, les pieds dans le sable tiède, au son d’un orchestre imaginaire. Puis nous nous sommes allongés sur la plage et nous avons fait l’amour comme si c’était la dernière fois de notre vie, comme si le lendemain nous allions mourir. On s’est endormi dans les bras l’un de l’autre pour se faire réveiller par le cri des mouettes et la fraîcheur du jour qui se levait. On a repris la route en direction de Chivirico, mais avant d’arriver à destination, on a été arrêté par un groupe d’hommes armés. Ils n’étaient pas en uniforme : c’était les hommes de Juan Almeida, l’un des lieutenants de Castro. L’ouverture d’un deuxième front avait débuté pendant la nuit dans la Sierra Madre. Maria a demandé à parler au lieutenant Almeida, ce qu’elle a obtenu sans grande difficulté. Moi, je n’ai pas été autorisé à l’accompagner et je suis resté sous bonne garde en attendant qu’elle revienne.
Quand je l’ai revue, elle était blanche comme un linge et ses yeux lançaient des éclairs. Elle était visiblement perturbée par la nouvelle qu’elle venait d’apprendre. Perturbée et aussi terriblement en colère ! Elle s’est jetée sur moi toutes griffes dehors.
- Gringo ! Hijo de puta ! Tu as tué mon père, tu m’as volé ma vengeance !
Je lui ai saisi les poignets pour éviter qu’elle ne m’arrache les yeux. Je ne comprenais rien à ce qu’elle me racontait. Je n’avais fait que frapper le gros flic qui s’était jeté sur elle, mais aucun de mes coups n’avaient pu entraîner sa mort ! Je lui demandais de me dire exactement ce qu’elle avait appris.
Almeida lui avait dit que son père avait été retrouvé poignardé au petit matin, en pleine rue, pas loin du bar où Maria travaillait. J’ai dû lui jurer mes grands dieux que jamais je ne me promenais avec une arme où même un couteau sur moi. Bien sûr j’avais toujours mon fameux canif suisse dans la poche mais ce n’est pas avec ce « jouet » que j’aurais pu faire du mal à qui que ce soit. Elle a seulement accepté de se calmer une fois que je lui ai montré le dit canif. Puisqu’il était encore dans ma poche, il ne pouvait pas se trouver dans le cœur de son père tant honni.
Ce gros flic pourri devait s’être fait tant d’ennemis parmi le petit peuple que l’une de ses anciennes victimes avait saisi l’occasion de le voir KO dans le caniveau pour mettre un terme définitif à sa vie corrompue. C’était la seule explication que je voyais et c’est celle que je présentais à Maria. Elle m’a juré qu’elle retrouverait le meurtrier de son père, ce rustre qui avait fait de sa vie et de celle de sa mère un enfer. Elle voulait retourner immédiatement à Santiago. Je refusais. J’étais au cœur de l’action. J’étais enfin tombé sur ces hommes que je cherchais depuis un mois. Il fallait absolument que Maria obtienne pour moi l’autorisation d’interviewer Almeida. Si je n’avais rien à envoyer avant la fin du mois à Paris, il y avait de fortes chances que je sois rappelé en France. Mon journal n’était pas trop regardant à la dépense mais il fallait absolument qu’ils aient quelque chose à publier si je voulais rester à Cuba.
Cette menace à peine cachée a semblé porter et Maria a accepté de faire l’intermédiaire entre Juan Almeida et moi. Il a fini par accepter de répondre à mes questions. Il m’accordait une demi-heure. C’était un petit homme sec à barbiche et moustache noire. Il avait le teint mat des descendants d’esclaves. Il m’a raconté la vie difficile dans les montagnes, l’exil au Mexique avec Fidel, les prisons de Batista, la révolution qui allait mettre fin à tout cela. Il m’a dit l’espoir du petit peuple qui allait se soulever, les rejoindre et jeter le gouvernement pourri de Batista hors de l’île. Et puis soudain il a décidé qu’il en avait assez dit. Ses hommes avaient besoin de lui sur le terrain. Il a simplement rajouté ceci :
- N’oublie pas de leur dire que le peuple souffre ici et que la révolution est la seule chance qui nous reste de retrouver notre liberté.
Je lui ai promis de ne pas trahir ses propos et je suis reparti avec Maria, direction Santiago de Cuba.
Sitôt arrivés dans la ville, nous avons du passer plusieurs barrages de militaires. La ville était en pleine effervescence. On entendait ça et là des coups de feu et des cris. Je me suis précipité à mon hôtel pour téléphoner au journal, à Paris. Il fallait qu’ils sachent ce qui se passait ici. J’ai dicté mon article à l’opératrice et je suis parti rejoindre Maria. Maintenant que son père était mort, on avait décidé de ne plus se quitter et de vivre ensemble. Peu importait le lendemain. Pour elle, seule la révolution comptait. Pour moi, seule comptait Maria, le fait de pouvoir rester à Cuba et de continuer à exercer mon métier de journaliste.
AVRIL
La vie a continué ainsi jusqu’au mois d’avril, au moment de la grève générale qui avait été prévue le neuf du mois. Les choses avaient été si mal planifiées qu’elle avait été rapidement étouffée par le gouvernement.
Maria disparaissait parfois pendant plusieurs jours. Je la voyais revenir affamée, épuisée mais plus belle et rebelle à chaque fois. Alors, nous faisions l’amour toute la journée. Elle me racontait la révolution, les soldats dans la sierra. Moi, je m’occupais de mes articles. Elle les relisait avant de m’autoriser à les envoyer pour publication. Les semaines passant, je devenais le journaliste officieux de la révolution cubaine. Le côté « vécu » de mes écrits commençait à avoir un franc succès en métropole et j’avais beaucoup moins de mal à obtenir des crédits lorsque le besoin s’en faisait sentir. Ma fidèle BSA m’emmenait partout à la rencontre du Cuba des paysans et des petites gens. La rencontre était souvent facilitée par ma machine pétaradante et atypique. Le contact était assurément plus facile que si j’avais débarqué au volant d’une grosse voiture américaine.
Le six mai, les choses ont sérieusement commencé à se dégrader pour nous à Santiago. L’armée avait décidé de lancer une grande offensive dans la Sierra Maestra pour tenter d’éliminer la guérilla castriste. D’importantes batailles avaient lieu. Maria m’avait annoncé que sa place se trouvait au milieu de ses frères et qu’elle allait les rejoindre le temps de repousser les troupes de Batista. Bien sûr, il était hors de question que je la laisse partir seule. J’ai assisté aux combats dans la Sierra à ses côtés. J’ai pris des photos, j’ai fait des interviews. Je m’étais fait envoyer une petite caméra super huit de France avec laquelle je filmais les accrochages, la vie de tous les jours, etc. Sans m’en rendre compte, je devenais reporter de guerre. Les combats ont duré trois longs mois. Trois mois durant lesquels Maria et moi on se voyait en coup de vent. Si moi je devenais reporter de guerre, elle se transformait lentement en véritable combattante. Elle avait lâché la cantine et la trousse de secours pour le fusil et la grenade. Chaque fois que l’on se voyait, on trouvait cependant le moyen de s’isoler une heure ou deux et on faisait l’amour comme des fous, comme des animaux, de façon sauvage et brutale.
Le sept août, on nous a informés que les troupes gouvernementales se retiraient de la Sierra Maestra, abandonnant la région aux castristes. Maria était folle de joie. Enfin une victoire ! Enfin la révolution avançait ! Il y a eu une réunion de tous les responsables du mouvement révolutionnaire, et grâce à Maria, j’ai eu la chance de pouvoir y assister de loin. En tout cas j’ai pu rencontrer et interviewer ses principaux acteurs. Comme de bien entendu, je suis arrivé à moto. Maria en passagère, le fusil à l’épaule, me servait de laissez-passer. J’ai pu photographier Fidel Castro et son frère Raul, Camilio Cienfuegos et quelques autres. A un moment, alors que je me trouvais près de la BSA à ranger mes affaires dans les sacoches, un grand type dégingandé s’est approché de moi. Il portait un béret noir avec une étoile rouge sur le devant. Il était mince, presque maigre et portait une barbe noire clairsemée. Il était vêtu d’un treillis kaki. Il a tourné autour de la moto en tirant des bouffées de son gros cigare. Puis il m’a demandé :
- Elle est à toi compañero ?
J’ai répondu par l’affirmative.
- Elle marche bien ? Elle roule vite ?
- Oui, elle fonctionne très bien.
- J’aime les motocicletas. Autrefois j’en avais une aussi, une vieille Norton.
Puis il est parti dans un grand éclat de rire. Un homme en arme est venu le chercher. Il m’a salué comme un camarade avant de le suivre. Je venais de rencontrer le Che !
C’est en août que les révolutionnaires se sont scindés pour approcher de Santa Clara. Cette ville représentait le nœud qui séparait l’île en deux. Elle était d’une importance stratégique fondamentale pour les révolutionnaires. Fin août, les troupes du Che et de Camilio Cienfuegos sont parties de l’est de Cuba pour rejoindre la région montagneuse de l’Escambray en six semaines de marche. Maria et moi avions décidé de les suivre : elle pour participer aux combats, moi pour continuer à jouer mon rôle de reporter et envoyer mes articles à Paris.
Une nuit où nous étions allongés à la belle étoile, j’ai demandé à Maria si elle pensait vraiment que c’était moi qui avais tué son père. La réponse s’est faite attendre dans le noir :
- Thom, si j’avais le moindre soupçon sur toi, je t’aurais déjà tué de mes propres mains.
Je ne comprenais pas son attitude. D’un côté elle détestait son père de son vivant, et pourtant elle rêvait de punir celui qui l’avait tué. Je lui ai fait part de mon étonnement à ce sujet. A force de douceur et de persuasion, elle a fini par me raconter toute l’histoire. Comme dit précédemment, son père était le chef de la police de Santiago de Cuba. C’était un homme influant mais aussi quelqu’un de corrompu et de violent. Toute son enfance, Maria l’avait passée sous les coups et les brimades. La violence était son lot quotidien. Son père n’avait cessé de lui répéter qu’elle n’était qu’une bonne à rien, qu’elle allait finir sur le trottoir. A force de l’entendre dire, elle avait presque fini par le croire. Elle avait déniché ce petit travail de serveuse dans le bar où je l’avais vue pour la première fois et participait ainsi aux besoins de la famille. Bien sûr, elle ne pouvait rien garder de sa petite paye pour elle. C’était son père qui allait ramasser son salaire chez le patron du bar. Il en profitait aussi pour se saouler gratuitement. Ceci aurait pu durer jusqu’à ce que Maria mette fin à ses jours (chose qu’elle avait sérieusement envisagé de faire), mais le destin avait mis sur son chemin un de ses anciens camarades d’école. Ce jeune homme nommé Valdes, lui avait parlé de la révolution qui grondait, des hommes qui se cachaient dans la Sierra, de leur but de renverser le gouvernement pourri de Batista. Maria avait tout de suite été emballée par cette proposition de les rejoindre. La seule idée de voir son père l’apprendre, lui redonnait le sourire. Il allait voir si elle n’était bonne à rien. Il allait voir si elle ne réussirait pas à faire quelque chose de grand de sa vie.
Elle dépendait du groupe de Juan Almeida et quand elle l’eut rencontré et que ce dernier lui a demandé de garder son poste de serveuse au bar, elle en a été extrêmement frustrée. Ce qu’elle voulait, elle, c’était combattre et surtout faire enrager son père avant de se venger personnellement de lui. Juan était parvenu à la convaincre qu’elle servirait bien mieux la révolution à son poste de serveuse. Qui mieux qu’elle pouvait les renseigner quant aux intentions de la police et de l’armée ? Qui mieux qu’elle pouvait entendre les conversations des militaires assis dans le bar ? Il avait bien fallu qu’elle se rende à l’évidence et se fasse une raison : elle était importante là où elle se trouvait et la révolution castriste avait besoin d’elle.
Maintenant, quelqu’un l’avait privée de sa vengeance : jamais plus elle ne pourrait lui jeter à la face qu’elle n’était pas aussi inutile que ce qu’il avait voulu lui faire croire. Elle était en passe de réussir quelque chose de beau et de grand dans sa vie ! Pour elle, la révolution voulait dire bien plus que de libérer son pays : la révolution devait la libérer elle, en faire une femme, un être humain à part entière. Pour Maria, bien plus que pour le reste de ses compagnons, c’était vaincre ou mourir.
Elle pleurait à présent à côté de moi. Je l’ai prise dans mes bras, je l’ai serrée très fort et je l’ai embrassée. Mon Dieu, que j’aimais cette femme, que je la respectais. Jamais plus je ne voulais la quitter. Je voulais passer le restant de ma vie avec elle ou mourir à ses côtés. Je lui ai dit qu’avec elle je voulais vivre et mourir, que nous irions tous les deux au bout de cette révolution, quoi qu’il nous en coûte. Je me souviendrai toute ma vie de cette nuit d’amour. Contrairement aux précédentes, elle a été douce et tendre. Elle n’a pas été comme une sorte de guerre mais plutôt comme une communion entre deux âmes.
A partir de septembre et jusqu’à fin octobre, la guérilla a continué à progresser depuis l’est vers l’ouest et aux alentours de Santa Clara. Je restais aux côtés de Maria, même pendant les batailles les plus sanglantes. Je n’étais plus le journaliste objectif et distant mais un acteur de cette bataille, prisonnier de mon cœur et des évènements.
Début novembre, le journal m’avait demandé de couvrir les élections présidentielles qui devaient avoir lieu partout dans l’île. Il m’avait fallu quinze jours pour recevoir le message de Paris. Il m’avait été transmis par l’opératrice du journal au moment où je dictais mon dernier article. Maria et moi étions entrés incognito à La Havane. Partout des soldats, des policiers et des américains un peu louches. Avec le recul et l’expérience, je peux dire que je n’ai jamais vu autant d’agents de la CIA qu’à ce moment là ! En fait personne n’a reconnu la légitimité de ces élections et j’avais l’impression que nous avions pris tous ces risques pour rien. Mais en laissant traîner nos yeux et nos oreilles, on avait fini par entendre certaines choses ! Le gouvernement allait tenter une contre-attaque dans l’Escambray. Aussitôt que nous avons réussi à accumuler assez d’indices pour corroborer ces rumeurs, nous avons enfourché la BSA pour rejoindre les guérilleros et les avertir de ce qui se préparait.
Nous sommes tombés nez à nez avec les hommes d’Ernesto Guevara entre Guama et Santa Clara, au centre de l’île le quatre décembre. Le Che a immédiatement décidé d’attaquer les régiments stationnés là. Il appliquait le vieil adage qui dit que souvent la meilleure défense réside dans l’attaque !
Pendant ce mois de décembre, Maria et moi nous ne nous sommes plus quittés, comme si nous avions senti que le destin qui nous avait été si favorable jusqu’à présent, allait se retourner contre nous.
Le vingt-cinq décembre n’a pas été un jour facile et la trêve de Noël n’a pas été respectée. Des combats violents se sont déroulés aux abords de Santa Clara. L’assaut final a eu lieu le dernier jour de mille neuf cent cinquante-huit et le dernier îlot de résistance de l’armée, sur la route de La Havane, est tombé ce jour là. Nous étions tous fous de joie. Tout le monde a beaucoup bu et chanté. Maria et moi, avons fait l’amour dans la cave à vin de la résidence du maire de la ville. Nous étions sales, épuisés, amaigris mais tellement heureux. Le premier janvier mille neuf cent cinquante-neuf, les troupes révolutionnaires entraient dans la capitale du pays. Si vous observez bien les films d’époque, vous verrez circuler au milieu de la foule une BSA Goldstar, transportant un jeune européen et une cubaine magnifique. Avant de fêter dignement la victoire finale (et ne plus être capable de rédiger une ligne), j’ai envoyé un dernier article à Paris. C’est à ce moment que l’opératrice m’a annoncé la mauvaise nouvelle : les gendarmes me cherchaient en France. L’état m’avait envoyé il y a un mois déjà mon ordre de mobilisation pour partir en Algérie. Je terminais une guerre pour assister à une autre, bien plus sale, bien moins noble (si tant est qu’une guerre puisse avoir quelque chose de noble). Il fallait que je rentre immédiatement. Le dernier avion d’une ligne régulière décollerait en direction de Miami à vingt-trois heures trente précise le soir même. Je ne pouvais pas le rater.
J’ai cherché Maria dans toute la ville, dans tous les bars. Je ne l’ai pas trouvée. Par chance, je suis tombé sur mon vieil ami Juan Montanez qui a été fou de joie de me revoir en vie. Il a fallu que je lui explique en deux mots ce qui m’arrivait et je lui ai fait promettre de retrouver Maria et de tout lui dire. La soirée était déjà bien avancée. Les minutes me filaient entre les doigts comme du sable. Il me fallait rejoindre l’aéroport et prendre le dernier avion. Je n’avais sur moi que mon matériel photo et pas un seul vêtement de rechange.
Les premières gouttes de pluie sont tombées au moment ou je m’approchais du vieux DC3. De l’autre côté du tarmac, Juan me regardait tristement, assis sur ma moto. Les dernières images qui me sont restées de Cuba, ce sont les rues éclairées de La Havane et la foule qui envahissait tout. J’ai collé mon front contre le petit hublot et j’ai prié en pleurant pour ce peuple qui avait tant souffert, pour mon amour perdu.
Je ne suis jamais retourné à Cuba. D’une république bananière, l’île est devenue une dictature. Moi, j’ai été envoyé en Algérie comme reporter de guerre au service de l’armée. J’y suis resté jusqu’à la fin, cadeau de la « grande muette » qui me soupçonnait d’avoir tenté d’échapper à mon service national de l’autre côté de l’océan.
Je suis arrivé au Havre tôt le matin, l’esprit embrumé par mes souvenirs et une nuit sans sommeil. Quand je me suis présenté au service des douanes, on m’a immédiatement dirigé vers le hangar où m’attendait mon « colis ». Elle était bien là, dans sa caisse. Oh bien sûr, elle n’était plus neuve, on voyait qu’elle avait vécu ! Le réservoir ressemblait à une balle de golf tant il y avait de bosses dessus. La peinture était passée et les chromes piqués. Mais c’était bien elle : la moto de mes vingt ans, la moto de la révolution cubaine. Les clés étaient sur le contact. Le porte-clés était fait d’une vieille cartouche de fusil. Quand je l’ai pris en main, la balle en est tombée, me laissant seulement avec la douille entre les doigts. En me penchant pour ramasser cette petite ogive de plomb, un rouleau de papier a glissé de la douille. Je l’ai ramassé et je l’ai ouvert délicatement. Voici ce que j’y ai lu :
Mon amour,
Si tu lis ce mot, c’est que tu as eu la moto qui nous a transportés quand nous avions vingt ans. Cela veut aussi dire que je ne suis plus de ce monde et que notre fils, Ernesto, a tenu sa promesse. Je t’aime pour toujours.
Hasta la vittoria, siempre !
Maria
Le 27 décembre 2007
P.S.
L’idée de cette nouvelle m’est venue plusieurs mois après avoir reçu d’un ami les photos de sa dernière acquisition : une BSA !
Cette moto était effectivement sortie en fraude dans un container de Cuba. Mais une photo ne fait pas une histoire... Il aura fallu une longue discussion avec une autre amie pour faire naître l’étincelle de cette nouvelle.
Merci à Mimi pour cela.
La réponse est tombée quelques heures plus tard par courrier électronique : motocyclette BSA type B34. Le courriel était accompagné du document des douanes certifiant que la marchandise avait été dédouanée dans les règles ainsi que d’une photo. Quand je l’ai vue, j’ai eu un grand choc. On y voyait effectivement une BSA Goldstar en caisse. Cette photo m’a ramené brutalement cinquante ans en arrière, à l’époque où j’avais vingt ans. Si je n’avais pas été assis, je me serais effondré sur place. Mes jambes flageolaient, sans force, mes mains tremblaient et ma vue se brouillait. Mon Dieu, cette moto ! Tous ces évènements qui remontaient si loin ! C’était au siècle dernier !
Le lendemain je suis monté dans le train pour le Havre. Une fois assis, je me suis laissé envahir par tous ces souvenirs. C’était à la fin des années cinquante, de l’autre côté de l’océan. C’était à Cuba !
JANVIER
Je venais de sortir de l’école de journalisme et je m’étais fait engager par un grand quotidien national. A cette époque, tous les yeux étaient tournés vers le ciel. On écoutait, fasciné et inquiet, les bip-bip de Spoutnik. C’était le début de la guerre en Algérie. Evidemment, pas question d’envoyer un bleu là-bas pour couvrir ces évènements. Comme je me languissais à Paris, mon rédacteur en chef, qui m’avait à la bonne, a décidé de m’envoyer à Cuba voir ce qui s’y passait. Une bande de rebelles avait tenté un débarquement en Décembre mille neuf cent cinquante six dans l’espoir de renverser le gouvernement du président Batista. Bien sûr, l’opération avait lamentablement échoué. Depuis, le pays sombrait lentement dans le chaos et la guerre civile.
Ainsi, quelques heures après le Jour de l’An mille neuf cent cinquante huit, je prenais un avion de la TWA en direction de la Floride. Je n’y séjournais que le temps de goûter aux hamburgers et au Coca-Cola avant de sauter dans un vieux DC3 qui m’a emmené directement à La Havane.
Le ciel était gris et plombé à mon arrivée, bien loin de l’image idyllique que je me faisais des Caraïbes. Une fois là-bas, j’ai pris rendez-vous avec notre contact sur place, un certain Juan Montanez. Le gars était sympathique. Il m’a expliqué la vie à Cuba, les magouilles, les filles, puis il m’a emmené dans un bar, dans les bas-fonds. Un orchestre jouait de la salsa. Nous, on s’est assis un peu à l’écart, dans la pénombre. Je me souviens qu’il y avait beaucoup de fumée. Forcément, on s’est mis à boire. Je devrais plutôt dire à picoler. Du gin, du whisky, du rhum, etc… des trucs d’hommes quoi ! Au bout d’un moment, la serveuse a refusé de nous servir, tellement on était saoul. Elle s’est mise à hurler après Juan et moi quand on a renversé plus de verres qu’on en a bu. Je me suis levé tant bien que mal, j’aie jeté un paquet de dollars US sur la table et on est sorti en beuglant et en chantant. Je ne me souviens même plus comment je me suis rendu à mon hôtel. Toujours est-il que lorsque je me suis réveillé, le lendemain matin, j’étais dans une magnifique chambre avec une superbe casquette plombée sur le crâne ! J’ai du traîner une bonne heure sur mon lit, incapable d’aligner deux pensées sensées de suite.
Quand la réception a appelé, la sonnerie du téléphone m’a vrillé les tympans.
- Monsieur Thomas Longchamps ?
- Mmmmh !
- Ici la réception Monsieur Longchamps. Monsieur Juan Montanez demande à vous voir.
- Faîtes-le monter… et amenez-moi aussi du café très fort.
La réceptionniste s’est empressée de me dire que Montanez était déjà en route et que le café arriverait sous peu. Juan est entré, gai comme un pinson, fringant, en pleine forme, comme s’il sortait d’une longue nuit de repos. A croire que l’alcool n’avait aucun effet sur lui. Il était un petit peu plus petit que moi, un peu plus âgé aussi. La moustache arrogante, le cheveu noir et bouclé et le teint mat.
- Buenos dias amigo ! Comment tu vas ?
- Impossible à dire pour le moment Juan. On en parlera quand j’aurai bu un café.
J’avais la langue pâteuse et l’haleine chargée. J’avais aussi besoin d’une bonne douche pour chasser les derniers miasmes de cette soirée.
Quand je suis ressorti de la salle de bain, j’avais les idées un peu plus claires. Tout en buvant un café noir comme l’enfer, j’ai parlé à Juan de ce que j’avais l’intention de faire. Il fallait absolument que je parvienne à approcher les rebelles pour décrocher une interview de leur chef, un certain Fidel Castro. Il me fallait aussi un moyen de transport léger et rapide qui puisse m’emmener partout dans l’île, même dans les endroits les moins accessibles. Juan a immédiatement pensé à une bonne Jeep mais j’ai refusé. Trop gros, trop … militaire et surtout j’aurais été obligé d’emmener Juan partout avec moi. Or, c’était exactement ce que je voulais éviter. Juan était sympathique, bon vivant et il connaissait beaucoup de monde, trop de monde peut-être. J’étais persuadé que pour pouvoir approcher les rebelles, il faudrait la jouer discret et silencieux. Tout le contraire de mon guide.
Donc, il me faudrait une moto. J’adorais la moto. Même chez nous, je roulais par tous les temps. A Paris, c’était beaucoup plus rapide (même s’il n’y avait pas encore autant de circulation que de nos jours) et plus drôle (quel plaisir de semer les « hirondelles » à vélo). Juan fît la moue. On voyait bien que cette histoire de « motocicleta » ne lui plaisait qu’à moitié, mais comme c’était moi qui le payais, il a fini par accepter. Pas le choix de toute façon. Il m’a promis qu’avant le soir même j’aurai mon engin. On s’est donné rendez-vous dans le même bar que celui de la veille, le Buena Vista Club, vers vingt heures. Après un « buen dia amigo ! » sonore, il est parti en me laissant fignoler mes plans. Après m’être habillé et avoir envoyé un télégramme à Paris pour donner de mes nouvelles, je suis sorti pour traîner dans les rues de La Havane. Je voulais prendre le pouls de cette ville, de cette nation. Partout où je passais, il y avait de la musique qui sortait d’une arrière cour, une femme qui chantait derrière ses fenêtres ouvertes ou des gamins qui riaient en jouant. Mais il y avait aussi des soldats qui patrouillaient, des flics, des « gringos » américains qui se prenaient pour les rois du monde. Beaucoup trop d’uniformes à mon goût et donc aucune chance de prendre contact avec les hommes de Castro. De toute façon personne ne savait exactement où ils se trouvaient. Il se passait des choses dans l’est de l’île et moi je me trouvais tout au nord-ouest, à huit cent kilomètres de là. Il me tardait d’avoir ma moto et de filer aussi vite que possible vers l’est. Pour occuper le restant de la journée, je décidais de me dégotter une carte et de préparer mon itinéraire vers Bayamo. Il fallait que je m’approche aussi près que possible de la zone que maîtrisaient les rebelles. J’avais l’intention de suivre la côte au nord de l’île. D’abord Varadero, Cardenas, Sagua La Grande, Moròn, Nuevitas, Holguin et enfin Bayamo. Suivant la situation là-bas, je pourrais toujours essayer de rejoindre Santiago de Cuba, à l’extrême sud du pays.
Le soir approchant, je rassemblais mes affaires, je vérifiais mon appareil photo, mes pellicules et je fourrais le tout dans un grand sac de paquetage kaki. Enfin l’heure de mon rendez-vous avec Juan est arrivée. Je me suis rendu au Buena Vista Club à l’heure dite. Il y avait encore peu de monde à cette heure-ci. Bien sûr Juan était en retard. J’ai commandé des langoustines. C’est au moment où j’ai commencé à manger que je me suis rendu compte à quel point j’avais faim. Si faim que j’ai commandé une deuxième assiette, sitôt la première vidée. Je venais à peine de l’entamer que j’ai entendu au dehors le son caractéristique d’un moteur monocylindre haut dans les tours. Se pouvait-il que ce soit Juan qui arrivait à moto ?
J’ai fait comme les autres clients du bar : je suis sorti pour voir ce qui causait tout ce bruit. C’était bien mon contact qui s’amusait à monter et descendre la rue à toute vitesse au guidon de son engin pétaradant. Quand il m’eut repéré au milieu de la foule, il s’est mis debout sur les cale-pied pour hurler au moment où il passait à ma hauteur :
- Tu avais raison Thomas, elle est super cette motocicleta ! Mui bien !
Quand il fut satisfait du nombre de spectateurs qui l’admirait, Juan a enfin décidé de s’arrêter pour me montrer sa trouvaille. Il s’agissait d’un véritable bijou : une BSA Goldstar. Cette moto était déjà rare et chère à l’époque.
- Tu es content Thom ? Tu sais ça n’a pas été facile d’en trouver une. Pourquoi tu ne voulais pas plutôt une Jeep ? Ça aurait été beaucoup plus facile et surtout moins cher !
Il m’avait dit cela sur le ton de la conspiration. Sans me laisser le temps d’admirer la machine, Juan m’a entraîné dans le bar et s’est jeté sur mon assiette de langoustines froides. Pour être franc, je n’ai pas compris grand’ chose aux explications qu’il m’a fournies, mais il m’a bien fait comprendre que c’était cher, très cher même.
Je n’étais pas encore assez bourré pour ne pas saisir le message caché. Je lui ai demandé combien cela me coûterait de récupérer la BSA. Là, d’un seul coup, il est redevenu sérieux comme un pape. Il a reposé la dernière langoustine dans l’assiette, s’est essuyé lentement les mains et m’a regardé droit dans les yeux.
- Thom mon frère, la motocicleta, là dehors, je l’ai pas vraiment achetée. Elle appartenait à un americano, mais il n’en a pas vraiment besoin. Donne-moi deux cent cinquante dollars et elle sera à toi.
C’était une sacrée somme ! Je savais pertinemment que ça ne passerait jamais sur une note de frais mais il me fallait absolument un véhicule pour rejoindre Bayamo. Je disposais en tout et pour tout de deux cents dollars en liquide à l’hôtel. J’expliquais la situation à Juan. Finalement, au bout d’une heure de discussion, il a accepté de descendre son prix. Une fois d’accord, on est reparti à fond de train dans les rues de La Havane, lui pilotant et moi en place passager. L’air frais du soir m’a aidé à retrouver mes esprits et je me suis rendu compte que Juan n’était pas aussi bon pilote que ça. On venait d’éviter notre troisième collision avec une voiture (une grosse Cadillac je crois) quand je lui ai tapé sur l’épaule. Tout en roulant il s’est mis à hurler :
- Qu’est ce qu’il y a amigo ?
- J’aimerais bien rouler aussi !
- Quoi ?
Le vent, le bruit du moteur ; Juan ne comprenait rien (ou ne voulait rien comprendre) à ce que je disais. Mais à force d’insister et de lui taper sur l’épaule, il a fini par s’arrêter le long de la route qui longe la mer. Je lui ai répété que je voulais rouler.
- OK amigo. Je vais t’expliquer comment la démarrer.
Pour ne pas vexer mon hôte, je n’ai rien dit. Je pilotais des anglaises depuis que mes jambes étaient assez longues pour toucher le sol une fois en selle.
On est rentré directement à l’hôtel où je me suis acquitté de ma dette. J’avais l’intention de partir de La Havane le lendemain à l’aube. Quand Juan a appris ça, il m’a emmené au bar de l’hôtel où on a bu jusqu’à plus soif à ses frais. Nos adieux ont été poignants. On ne se connaissait pas depuis deux jours qu’il me considérait déjà comme son frère ( un frère qu’il avait allégé de deux cents dollars quand même) !
Le lendemain, avant de partir, j’ai appelé le journal à Paris pour les informer de mes intentions pour les prochaines semaines. Je ne savais pas quand je pourrais les joindre à nouveau et je voulais qu’ils le sachent.
Le démarrage à froid de la BSA était un véritable cérémonial :
Il fallait ouvrir l’essence et titiller le carburateur jusqu’à ce que la cuve déborde, puis tirer la poignée d’embrayage et donner un coup de kick pour vérifier qu’il ne collait pas. Donner deux coups de kick, mettre le contact et un poil de gaz. Enfin donner un dernier coup de kick énergique mais pas bourrin et c’était parti ! Tout dans la classe et la décontraction. Le temps que la moto chauffe gentiment sur sa béquille, j’ai accroché mon paquetage sur la selle passager et j’ai payé ma note. Comme il ne me restait plus un sou, j’avais demandé une avance sur mon salaire. Le boss avait râlé au téléphone, surtout que je n’avais pas encore pondu un seul article. Il avait fallu que je lui explique que les rebelles essayaient de contrôler l’est de l’île et qu’il fallait que je m’y rende pour avoir quelque chose à raconter.
Je me suis rapidement mis en route, direction Varadero. Cette ville se trouvait à une bonne centaine de kilomètres de La Havane et il m’a fallu plus de deux heures pour la rejoindre. Mais peu m’importait, je n’étais pas pressé. Je pensais atteindre Moron avant la fin de la journée, mais dans la Caraïbe les choses ne se passent jamais comme prévu. A force de m’arrêter pour admirer le paysage, la mer, de prendre des photos pour mes futurs articles, je ne suis pas arrivé plus loin que Sagua La Grande. J’ai foncé dans le seul hôtel pas trop miteux de cette ville pour y prendre quelques heures de repos. Comme je n’arrivais pas à dormir, j’ai décidé de me relever pour aller traîner dans les rues animées de cette citée. Je me suis laissé attirer par la musique d’un petit bar et tout en m’asseyant à une table, j’ai commandé un rhum. La serveuse a semblé surprise. D’habitude les « gringos » préféraient le whisky à la boisson locale. J’ai pris soin cette fois-ci de ne pas boire plus que de raison.
Le lendemain, je suis reparti sur ma vaillante BSA en direction de Moron. Partout je voyais le petit peuple cubain au travail, s’exténuant au service des grands propriétaires terriens. Partout je voyais la misère et l’oppression. Je commençais enfin à toucher du doigt l’âme de cette île, de son peuple. Je me suis arrêté plus souvent, plus longtemps pour parler aux cubains de souche. Il y avait toujours dans leurs yeux cette crainte de l’homme blanc, du patron, du chef d’exploitation, qui était plus prompt à frapper qu’à discuter. Quand j’ai compris cela, j’ai peaufiné ma technique. J’abordais les travailleurs à l’ouvrage dans les champs sous prétexte de demander mon chemin. Je faisais mine de chercher mes mots pour bien faire comprendre que je n’étais pas américain mais français. Je devenais bien vite le Français à la motocicleta, et le soir quand je me promenais en ville, certains me reconnaissaient. Il suffisait alors de quelques verres pour qu’ils me parlent ouvertement de leur vie de misère, de leur patron et de leurs aspirations. Quand je demandais s’ils savaient quelque chose à propos des rebelles, certains se taisaient, mais la majorité d’entre eux en avaient seulement vaguement entendu parler. Ils étaient loin, plus loin à l’est. Ils étaient presque tous morts à Cienfuegos à la fin de l’année précédente, écrasés sous les bombes des B26 américains.
Après Moron, ma route m’a conduit vers Esmeralda. Quel joli nom, quelle affreuse ville. J’y ai assisté en plein jour à l’assassinat d’un paysan : le gouverneur local le soupçonnait d’avoir apporté son soutien aux révolutionnaires ! Plus je me dirigeais vers l’est de l’île et moins on les appelait des rebelles. Après Esmeralda, ce fût Nuevitas, Las Tunas, Holguin, puis Bayamo. Partout la même misère, la même oppression. En arrivant à Bayamo, j’ai senti une certaine tension dans la ville, comme de l’électricité dans l’air. Il y avait beaucoup plus de militaires et de flics dans les rues que partout ailleurs dans l’île. Les contrôles d’identité étaient plus fréquents mais aucune destination ne m’était encore interdite. Il faut dire que le fait de voyager à motocyclette m’attirait plus la sympathie de ceux que je croisais que la suspicion. Et puis, je ne me gênais pas pour forcer mon accent français et préciser que j’étais journaliste. Il me suffisait alors de prendre le chef des pandores en photo, assis sur ma moto, et de lui promettre de la lui envoyer pour qu’on me fiche la paix et qu’on me laisse continuer mon périple.
Après avoir traîné à Bayamo quelques jours sans y récolter la moindre information intéressante, ni y voir l’ombre d’un révolutionnaire, j’ai décidé de pousser jusqu’à Santiago de Cuba. Je commençais à me poser des questions : et si toute cette histoire de Castro et de débarquement n’était plus que des informations éventées ? Et si tout cela s’était terminé en Septembre mille neuf cent cinquante-sept sous les bombes américaines, à Cienfuegos ?
J’ai décidé que si je ne voyais rien de plus intéressantes une fois arrivé à Santiago, je regagnerai La Havane et la France au plus vite. Je suis arrivé à Santiago à la tombée du jour, et conformément à mes habitudes, j’ai traîné deux bonnes heures dans les rues de cette ville. Bien qu’il n’y ait pas de couvre-feu en vigueur, elles étaient presque désertes. Je suis entré dans le premier bar dont la musique m’attirait. C’est là que je l’ai vue pour la première fois ! Elle était belle, svelte et bien faite de sa personne. Elle portait ses longs cheveux noirs tressés en une natte qui se balançait au rythme de sa démarche souple. Ses yeux tristes et sombres, lançaient parfois des éclairs de haine. Je ne me souviens plus de ce qui m’a le plus attiré en elle. Maria était serveuse dans ce bar sombre dont l’air était lourd de la fumée des cigares. L’atmosphère y était chaude, presque suffocante. J’ai eu du mal à passer ma commande tant elle me fascinait et il a fallu que je m’y reprenne à deux fois pour demander une bière.
Je suis resté là une bonne partie de la nuit à l’observer et à siroter ma Budweiser, ne recommandant que lorsqu’elle venait me relancer. Je ne suis rentré à mon hôtel que très tard dans la nuit, quand le bar a fermé et que l’on m’a chassé avec les derniers clients.
Le lendemain, je me suis mis à la recherche de quelqu’un qui pourrait me mettre en contact avec les hommes de Castro, voir même avec leur chef lui-même. J’ai tourné dans la région pendant des jours, suivant ici et là les « on dit » et les rumeurs. Mais soit il ne se passait rien quand j’arrivais, soit l’accrochage entre les soldats et les rebelles était déjà terminé. J’avais même, je dois l’avouer, le sentiment que l’on me renseignait mal à dessein, afin me tenir à l’écart de l’action. Et chaque soir je rentrais bredouille, sans avoir ramené la moindre photo, sans avoir assisté au moindre combat. Je me rendais directement au bar où Maria servait et je passais ma soirée à la dévorer des yeux.
FEVRIER
On était à la veille du vingt-sept Février mille neuf cent cinquante-huit quand Maria est venue me voir à ma table. Quand elle s’est approchée de son pas chaloupé, mon cœur s’est mis à battre un peu plus fort. Que me voulait-elle ? Je venais de commander un rhum et mon verre était encore plein. Qu’allais-je pouvoir lui dire pour qu’elle reste un peu plus longtemps près de moi ? Elle s’est penchée par dessus la table, m’offrant le spectacle divin du haut de son décolleté. Elle s’est approchée tout près et m’a chuchoté la chose suivante à l’oreille :
- Gringo, si demain tu veux survivre, ne sors pas de Santiago. Après tu auras ce que tu cherches.
Sans un mot de plus, elle s’est éloignée pour reprendre son service au milieu de la musique et de la fumée. J’en suis resté bouche bée un bon moment. Quand elle est repassée à proximité de ma table, je lui ai attrapé le poignet. Le regard qu’elle m’a lancé était si noir que je l’ai immédiatement relâchée. Mais je lui ai quand même posé la question qui me brûlait les lèvres :
- Que va-t-il se passer demain signora ?
- Ne m’en demande pas plus. Si tu veux obtenir ce que tu cherches, fais ce que je t’ai dit !
Plusieurs paires d’yeux s’étaient tournées vers nous et j’ai préféré ne pas insister, mais j’ai décidé d’attendre Maria à la fin de son service. Il fallait que je sache de quoi elle voulait parler.
L’entrée du personnel se situait dans la petite cour de l’immeuble où se trouvait la taverne. J’ai fait les cent pas en attendant de la voir venir et au moment où elle est apparue, un gros type en uniforme est sorti de l’ombre et s’est rué sur elle en hurlant et en l’insultant. Quand il l’a saisie par le bras et l’a jetée à terre, mon sang n’a fait qu’un tour. Sans réfléchir, je me suis précipité pour lui porter secours. J’ai porté un direct du droit au gros flic qui a basculé dans le caniveau. Je me suis acharné sur lui à coup de poings et de pieds. C’est à peine si j’entendais Maria hurler, me supplier d’arrêter, me tirer par le bras. Quand elle est enfin parvenue à m’arracher à son agresseur, on s’est enfui en courant. Elle ne cessait de crier que j’étais « loco » et que j’allais payer très cher ce que je venais de faire. Elle m’a conseillé de prendre ma moto et de ficher immédiatement le camp de la ville, de quitter la région et même l’île. J’ai refusé de lui obéir tant qu’elle ne m’aurait pas dit ce qui allait se passer le lendemain. Ses menaces n’y ont rien fait. Finalement on en est arrivé à un compromis : je cherchais ma BSA à l’hôtel et elle acceptait de m’accompagner hors de la ville pour tout m’expliquer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et nous voilà en route en pleine nuit vers Chivirico. On s’est arrêté sur la plage et elle m’a tout raconté. Elle m’a prévenu qu’une fois que je serai au courant, ma vie à Cuba ne pourrait plus jamais être comme avant. Mais je venais de battre un agent de police comme plâtre : ma vie ne pourrait de toute façon plus jamais être comme avant !
Le pandore que je venais de rosser était son père. Il était venu lui soutirer des informations. Il l’a soupçonnait, à raison, de faire partie des révolutionnaires qui sévissaient dans la région. Le vingt-sept février, les rebelles avaient prévu d’augmenter les opérations de guérilla et d’ouvrir un second front au nord de Santiago. Mon intervention risquait de mettre en péril cette opération. Son père, chef de la police de Santiago, allait certainement mettre tout le monde disponible à notre recherche. Il ne nous restait qu’une seule solution : rejoindre les combattants castristes pour échapper aux recherches.
Je me rappelle que la nuit était douce et claire et que l’étoile du berger brillait fort. Maria semblait perdue et triste. J’ai rassemblé du bois mort et j’ai fait un feu sur la plage. Malgré la température relativement clémente, elle frissonnait. Je l’ai prise dans mes bras pour la réchauffer. Je l’ai sentie se raidir quand je l’ai embrassée mais elle n’a pas opposé de résistance à mon étreinte. L’obscurité m’a aidé à lui avouer ce que je ressentais pour elle. Je lui ai dit mon amour, sa beauté qui me fascinait, ses yeux qui me charmaient et me faisaient peur aussi. Il me semblait que c’était la première fois que quelqu’un lui faisait une déclaration d’amour aussi sincère. Cette nuit-là, nous nous sommes enlacés, nous avons dansé, joue contre joue, les pieds dans le sable tiède, au son d’un orchestre imaginaire. Puis nous nous sommes allongés sur la plage et nous avons fait l’amour comme si c’était la dernière fois de notre vie, comme si le lendemain nous allions mourir. On s’est endormi dans les bras l’un de l’autre pour se faire réveiller par le cri des mouettes et la fraîcheur du jour qui se levait. On a repris la route en direction de Chivirico, mais avant d’arriver à destination, on a été arrêté par un groupe d’hommes armés. Ils n’étaient pas en uniforme : c’était les hommes de Juan Almeida, l’un des lieutenants de Castro. L’ouverture d’un deuxième front avait débuté pendant la nuit dans la Sierra Madre. Maria a demandé à parler au lieutenant Almeida, ce qu’elle a obtenu sans grande difficulté. Moi, je n’ai pas été autorisé à l’accompagner et je suis resté sous bonne garde en attendant qu’elle revienne.
Quand je l’ai revue, elle était blanche comme un linge et ses yeux lançaient des éclairs. Elle était visiblement perturbée par la nouvelle qu’elle venait d’apprendre. Perturbée et aussi terriblement en colère ! Elle s’est jetée sur moi toutes griffes dehors.
- Gringo ! Hijo de puta ! Tu as tué mon père, tu m’as volé ma vengeance !
Je lui ai saisi les poignets pour éviter qu’elle ne m’arrache les yeux. Je ne comprenais rien à ce qu’elle me racontait. Je n’avais fait que frapper le gros flic qui s’était jeté sur elle, mais aucun de mes coups n’avaient pu entraîner sa mort ! Je lui demandais de me dire exactement ce qu’elle avait appris.
Almeida lui avait dit que son père avait été retrouvé poignardé au petit matin, en pleine rue, pas loin du bar où Maria travaillait. J’ai dû lui jurer mes grands dieux que jamais je ne me promenais avec une arme où même un couteau sur moi. Bien sûr j’avais toujours mon fameux canif suisse dans la poche mais ce n’est pas avec ce « jouet » que j’aurais pu faire du mal à qui que ce soit. Elle a seulement accepté de se calmer une fois que je lui ai montré le dit canif. Puisqu’il était encore dans ma poche, il ne pouvait pas se trouver dans le cœur de son père tant honni.
Ce gros flic pourri devait s’être fait tant d’ennemis parmi le petit peuple que l’une de ses anciennes victimes avait saisi l’occasion de le voir KO dans le caniveau pour mettre un terme définitif à sa vie corrompue. C’était la seule explication que je voyais et c’est celle que je présentais à Maria. Elle m’a juré qu’elle retrouverait le meurtrier de son père, ce rustre qui avait fait de sa vie et de celle de sa mère un enfer. Elle voulait retourner immédiatement à Santiago. Je refusais. J’étais au cœur de l’action. J’étais enfin tombé sur ces hommes que je cherchais depuis un mois. Il fallait absolument que Maria obtienne pour moi l’autorisation d’interviewer Almeida. Si je n’avais rien à envoyer avant la fin du mois à Paris, il y avait de fortes chances que je sois rappelé en France. Mon journal n’était pas trop regardant à la dépense mais il fallait absolument qu’ils aient quelque chose à publier si je voulais rester à Cuba.
Cette menace à peine cachée a semblé porter et Maria a accepté de faire l’intermédiaire entre Juan Almeida et moi. Il a fini par accepter de répondre à mes questions. Il m’accordait une demi-heure. C’était un petit homme sec à barbiche et moustache noire. Il avait le teint mat des descendants d’esclaves. Il m’a raconté la vie difficile dans les montagnes, l’exil au Mexique avec Fidel, les prisons de Batista, la révolution qui allait mettre fin à tout cela. Il m’a dit l’espoir du petit peuple qui allait se soulever, les rejoindre et jeter le gouvernement pourri de Batista hors de l’île. Et puis soudain il a décidé qu’il en avait assez dit. Ses hommes avaient besoin de lui sur le terrain. Il a simplement rajouté ceci :
- N’oublie pas de leur dire que le peuple souffre ici et que la révolution est la seule chance qui nous reste de retrouver notre liberté.
Je lui ai promis de ne pas trahir ses propos et je suis reparti avec Maria, direction Santiago de Cuba.
Sitôt arrivés dans la ville, nous avons du passer plusieurs barrages de militaires. La ville était en pleine effervescence. On entendait ça et là des coups de feu et des cris. Je me suis précipité à mon hôtel pour téléphoner au journal, à Paris. Il fallait qu’ils sachent ce qui se passait ici. J’ai dicté mon article à l’opératrice et je suis parti rejoindre Maria. Maintenant que son père était mort, on avait décidé de ne plus se quitter et de vivre ensemble. Peu importait le lendemain. Pour elle, seule la révolution comptait. Pour moi, seule comptait Maria, le fait de pouvoir rester à Cuba et de continuer à exercer mon métier de journaliste.
AVRIL
La vie a continué ainsi jusqu’au mois d’avril, au moment de la grève générale qui avait été prévue le neuf du mois. Les choses avaient été si mal planifiées qu’elle avait été rapidement étouffée par le gouvernement.
Maria disparaissait parfois pendant plusieurs jours. Je la voyais revenir affamée, épuisée mais plus belle et rebelle à chaque fois. Alors, nous faisions l’amour toute la journée. Elle me racontait la révolution, les soldats dans la sierra. Moi, je m’occupais de mes articles. Elle les relisait avant de m’autoriser à les envoyer pour publication. Les semaines passant, je devenais le journaliste officieux de la révolution cubaine. Le côté « vécu » de mes écrits commençait à avoir un franc succès en métropole et j’avais beaucoup moins de mal à obtenir des crédits lorsque le besoin s’en faisait sentir. Ma fidèle BSA m’emmenait partout à la rencontre du Cuba des paysans et des petites gens. La rencontre était souvent facilitée par ma machine pétaradante et atypique. Le contact était assurément plus facile que si j’avais débarqué au volant d’une grosse voiture américaine.
MAI
Le six mai, les choses ont sérieusement commencé à se dégrader pour nous à Santiago. L’armée avait décidé de lancer une grande offensive dans la Sierra Maestra pour tenter d’éliminer la guérilla castriste. D’importantes batailles avaient lieu. Maria m’avait annoncé que sa place se trouvait au milieu de ses frères et qu’elle allait les rejoindre le temps de repousser les troupes de Batista. Bien sûr, il était hors de question que je la laisse partir seule. J’ai assisté aux combats dans la Sierra à ses côtés. J’ai pris des photos, j’ai fait des interviews. Je m’étais fait envoyer une petite caméra super huit de France avec laquelle je filmais les accrochages, la vie de tous les jours, etc. Sans m’en rendre compte, je devenais reporter de guerre. Les combats ont duré trois longs mois. Trois mois durant lesquels Maria et moi on se voyait en coup de vent. Si moi je devenais reporter de guerre, elle se transformait lentement en véritable combattante. Elle avait lâché la cantine et la trousse de secours pour le fusil et la grenade. Chaque fois que l’on se voyait, on trouvait cependant le moyen de s’isoler une heure ou deux et on faisait l’amour comme des fous, comme des animaux, de façon sauvage et brutale.
AOUT
Le sept août, on nous a informés que les troupes gouvernementales se retiraient de la Sierra Maestra, abandonnant la région aux castristes. Maria était folle de joie. Enfin une victoire ! Enfin la révolution avançait ! Il y a eu une réunion de tous les responsables du mouvement révolutionnaire, et grâce à Maria, j’ai eu la chance de pouvoir y assister de loin. En tout cas j’ai pu rencontrer et interviewer ses principaux acteurs. Comme de bien entendu, je suis arrivé à moto. Maria en passagère, le fusil à l’épaule, me servait de laissez-passer. J’ai pu photographier Fidel Castro et son frère Raul, Camilio Cienfuegos et quelques autres. A un moment, alors que je me trouvais près de la BSA à ranger mes affaires dans les sacoches, un grand type dégingandé s’est approché de moi. Il portait un béret noir avec une étoile rouge sur le devant. Il était mince, presque maigre et portait une barbe noire clairsemée. Il était vêtu d’un treillis kaki. Il a tourné autour de la moto en tirant des bouffées de son gros cigare. Puis il m’a demandé :
- Elle est à toi compañero ?
J’ai répondu par l’affirmative.
- Elle marche bien ? Elle roule vite ?
- Oui, elle fonctionne très bien.
- J’aime les motocicletas. Autrefois j’en avais une aussi, une vieille Norton.
Puis il est parti dans un grand éclat de rire. Un homme en arme est venu le chercher. Il m’a salué comme un camarade avant de le suivre. Je venais de rencontrer le Che !
C’est en août que les révolutionnaires se sont scindés pour approcher de Santa Clara. Cette ville représentait le nœud qui séparait l’île en deux. Elle était d’une importance stratégique fondamentale pour les révolutionnaires. Fin août, les troupes du Che et de Camilio Cienfuegos sont parties de l’est de Cuba pour rejoindre la région montagneuse de l’Escambray en six semaines de marche. Maria et moi avions décidé de les suivre : elle pour participer aux combats, moi pour continuer à jouer mon rôle de reporter et envoyer mes articles à Paris.
Une nuit où nous étions allongés à la belle étoile, j’ai demandé à Maria si elle pensait vraiment que c’était moi qui avais tué son père. La réponse s’est faite attendre dans le noir :
- Thom, si j’avais le moindre soupçon sur toi, je t’aurais déjà tué de mes propres mains.
Je ne comprenais pas son attitude. D’un côté elle détestait son père de son vivant, et pourtant elle rêvait de punir celui qui l’avait tué. Je lui ai fait part de mon étonnement à ce sujet. A force de douceur et de persuasion, elle a fini par me raconter toute l’histoire. Comme dit précédemment, son père était le chef de la police de Santiago de Cuba. C’était un homme influant mais aussi quelqu’un de corrompu et de violent. Toute son enfance, Maria l’avait passée sous les coups et les brimades. La violence était son lot quotidien. Son père n’avait cessé de lui répéter qu’elle n’était qu’une bonne à rien, qu’elle allait finir sur le trottoir. A force de l’entendre dire, elle avait presque fini par le croire. Elle avait déniché ce petit travail de serveuse dans le bar où je l’avais vue pour la première fois et participait ainsi aux besoins de la famille. Bien sûr, elle ne pouvait rien garder de sa petite paye pour elle. C’était son père qui allait ramasser son salaire chez le patron du bar. Il en profitait aussi pour se saouler gratuitement. Ceci aurait pu durer jusqu’à ce que Maria mette fin à ses jours (chose qu’elle avait sérieusement envisagé de faire), mais le destin avait mis sur son chemin un de ses anciens camarades d’école. Ce jeune homme nommé Valdes, lui avait parlé de la révolution qui grondait, des hommes qui se cachaient dans la Sierra, de leur but de renverser le gouvernement pourri de Batista. Maria avait tout de suite été emballée par cette proposition de les rejoindre. La seule idée de voir son père l’apprendre, lui redonnait le sourire. Il allait voir si elle n’était bonne à rien. Il allait voir si elle ne réussirait pas à faire quelque chose de grand de sa vie.
Elle dépendait du groupe de Juan Almeida et quand elle l’eut rencontré et que ce dernier lui a demandé de garder son poste de serveuse au bar, elle en a été extrêmement frustrée. Ce qu’elle voulait, elle, c’était combattre et surtout faire enrager son père avant de se venger personnellement de lui. Juan était parvenu à la convaincre qu’elle servirait bien mieux la révolution à son poste de serveuse. Qui mieux qu’elle pouvait les renseigner quant aux intentions de la police et de l’armée ? Qui mieux qu’elle pouvait entendre les conversations des militaires assis dans le bar ? Il avait bien fallu qu’elle se rende à l’évidence et se fasse une raison : elle était importante là où elle se trouvait et la révolution castriste avait besoin d’elle.
Maintenant, quelqu’un l’avait privée de sa vengeance : jamais plus elle ne pourrait lui jeter à la face qu’elle n’était pas aussi inutile que ce qu’il avait voulu lui faire croire. Elle était en passe de réussir quelque chose de beau et de grand dans sa vie ! Pour elle, la révolution voulait dire bien plus que de libérer son pays : la révolution devait la libérer elle, en faire une femme, un être humain à part entière. Pour Maria, bien plus que pour le reste de ses compagnons, c’était vaincre ou mourir.
Elle pleurait à présent à côté de moi. Je l’ai prise dans mes bras, je l’ai serrée très fort et je l’ai embrassée. Mon Dieu, que j’aimais cette femme, que je la respectais. Jamais plus je ne voulais la quitter. Je voulais passer le restant de ma vie avec elle ou mourir à ses côtés. Je lui ai dit qu’avec elle je voulais vivre et mourir, que nous irions tous les deux au bout de cette révolution, quoi qu’il nous en coûte. Je me souviendrai toute ma vie de cette nuit d’amour. Contrairement aux précédentes, elle a été douce et tendre. Elle n’a pas été comme une sorte de guerre mais plutôt comme une communion entre deux âmes.
SEPTEMBRE
A partir de septembre et jusqu’à fin octobre, la guérilla a continué à progresser depuis l’est vers l’ouest et aux alentours de Santa Clara. Je restais aux côtés de Maria, même pendant les batailles les plus sanglantes. Je n’étais plus le journaliste objectif et distant mais un acteur de cette bataille, prisonnier de mon cœur et des évènements.
Début novembre, le journal m’avait demandé de couvrir les élections présidentielles qui devaient avoir lieu partout dans l’île. Il m’avait fallu quinze jours pour recevoir le message de Paris. Il m’avait été transmis par l’opératrice du journal au moment où je dictais mon dernier article. Maria et moi étions entrés incognito à La Havane. Partout des soldats, des policiers et des américains un peu louches. Avec le recul et l’expérience, je peux dire que je n’ai jamais vu autant d’agents de la CIA qu’à ce moment là ! En fait personne n’a reconnu la légitimité de ces élections et j’avais l’impression que nous avions pris tous ces risques pour rien. Mais en laissant traîner nos yeux et nos oreilles, on avait fini par entendre certaines choses ! Le gouvernement allait tenter une contre-attaque dans l’Escambray. Aussitôt que nous avons réussi à accumuler assez d’indices pour corroborer ces rumeurs, nous avons enfourché la BSA pour rejoindre les guérilleros et les avertir de ce qui se préparait.
Nous sommes tombés nez à nez avec les hommes d’Ernesto Guevara entre Guama et Santa Clara, au centre de l’île le quatre décembre. Le Che a immédiatement décidé d’attaquer les régiments stationnés là. Il appliquait le vieil adage qui dit que souvent la meilleure défense réside dans l’attaque !
DECEMBRE
Pendant ce mois de décembre, Maria et moi nous ne nous sommes plus quittés, comme si nous avions senti que le destin qui nous avait été si favorable jusqu’à présent, allait se retourner contre nous.
Le vingt-cinq décembre n’a pas été un jour facile et la trêve de Noël n’a pas été respectée. Des combats violents se sont déroulés aux abords de Santa Clara. L’assaut final a eu lieu le dernier jour de mille neuf cent cinquante-huit et le dernier îlot de résistance de l’armée, sur la route de La Havane, est tombé ce jour là. Nous étions tous fous de joie. Tout le monde a beaucoup bu et chanté. Maria et moi, avons fait l’amour dans la cave à vin de la résidence du maire de la ville. Nous étions sales, épuisés, amaigris mais tellement heureux. Le premier janvier mille neuf cent cinquante-neuf, les troupes révolutionnaires entraient dans la capitale du pays. Si vous observez bien les films d’époque, vous verrez circuler au milieu de la foule une BSA Goldstar, transportant un jeune européen et une cubaine magnifique. Avant de fêter dignement la victoire finale (et ne plus être capable de rédiger une ligne), j’ai envoyé un dernier article à Paris. C’est à ce moment que l’opératrice m’a annoncé la mauvaise nouvelle : les gendarmes me cherchaient en France. L’état m’avait envoyé il y a un mois déjà mon ordre de mobilisation pour partir en Algérie. Je terminais une guerre pour assister à une autre, bien plus sale, bien moins noble (si tant est qu’une guerre puisse avoir quelque chose de noble). Il fallait que je rentre immédiatement. Le dernier avion d’une ligne régulière décollerait en direction de Miami à vingt-trois heures trente précise le soir même. Je ne pouvais pas le rater.
J’ai cherché Maria dans toute la ville, dans tous les bars. Je ne l’ai pas trouvée. Par chance, je suis tombé sur mon vieil ami Juan Montanez qui a été fou de joie de me revoir en vie. Il a fallu que je lui explique en deux mots ce qui m’arrivait et je lui ai fait promettre de retrouver Maria et de tout lui dire. La soirée était déjà bien avancée. Les minutes me filaient entre les doigts comme du sable. Il me fallait rejoindre l’aéroport et prendre le dernier avion. Je n’avais sur moi que mon matériel photo et pas un seul vêtement de rechange.
Les premières gouttes de pluie sont tombées au moment ou je m’approchais du vieux DC3. De l’autre côté du tarmac, Juan me regardait tristement, assis sur ma moto. Les dernières images qui me sont restées de Cuba, ce sont les rues éclairées de La Havane et la foule qui envahissait tout. J’ai collé mon front contre le petit hublot et j’ai prié en pleurant pour ce peuple qui avait tant souffert, pour mon amour perdu.
Je ne suis jamais retourné à Cuba. D’une république bananière, l’île est devenue une dictature. Moi, j’ai été envoyé en Algérie comme reporter de guerre au service de l’armée. J’y suis resté jusqu’à la fin, cadeau de la « grande muette » qui me soupçonnait d’avoir tenté d’échapper à mon service national de l’autre côté de l’océan.
Je suis arrivé au Havre tôt le matin, l’esprit embrumé par mes souvenirs et une nuit sans sommeil. Quand je me suis présenté au service des douanes, on m’a immédiatement dirigé vers le hangar où m’attendait mon « colis ». Elle était bien là, dans sa caisse. Oh bien sûr, elle n’était plus neuve, on voyait qu’elle avait vécu ! Le réservoir ressemblait à une balle de golf tant il y avait de bosses dessus. La peinture était passée et les chromes piqués. Mais c’était bien elle : la moto de mes vingt ans, la moto de la révolution cubaine. Les clés étaient sur le contact. Le porte-clés était fait d’une vieille cartouche de fusil. Quand je l’ai pris en main, la balle en est tombée, me laissant seulement avec la douille entre les doigts. En me penchant pour ramasser cette petite ogive de plomb, un rouleau de papier a glissé de la douille. Je l’ai ramassé et je l’ai ouvert délicatement. Voici ce que j’y ai lu :
Mon amour,
Si tu lis ce mot, c’est que tu as eu la moto qui nous a transportés quand nous avions vingt ans. Cela veut aussi dire que je ne suis plus de ce monde et que notre fils, Ernesto, a tenu sa promesse. Je t’aime pour toujours.
Hasta la vittoria, siempre !
Maria
Le 27 décembre 2007
P.S.
L’idée de cette nouvelle m’est venue plusieurs mois après avoir reçu d’un ami les photos de sa dernière acquisition : une BSA !
Cette moto était effectivement sortie en fraude dans un container de Cuba. Mais une photo ne fait pas une histoire... Il aura fallu une longue discussion avec une autre amie pour faire naître l’étincelle de cette nouvelle.
Merci à Mimi pour cela.

froggyfr99- Un singe en été !
- Messages : 3518
Date d'inscription : 12/03/2011
Localisation : A-AR-CH-LOR
 Sujets similaires
Sujets similaires» [COMPLET] dernière minute 1 place libre pour we de pentecôte au lac du der
» Jeudi 12 décembre
» Vendredi 4 decembre
» Salon de la moto le 8 décembre
» Ballade caratmotard [ 18 décembre 14 ]
» Jeudi 12 décembre
» Vendredi 4 decembre
» Salon de la moto le 8 décembre
» Ballade caratmotard [ 18 décembre 14 ]
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|